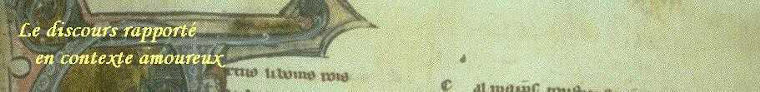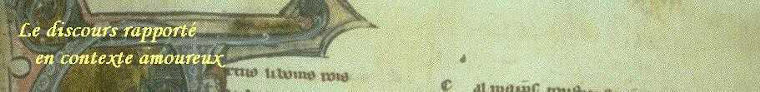| |
«Aux
origines du discours indirect libre : le Roman de Brut de Wace»
Danielle
Forget, Pierre
Kunstmann, France
Martineau
Université d'Ottawa
|
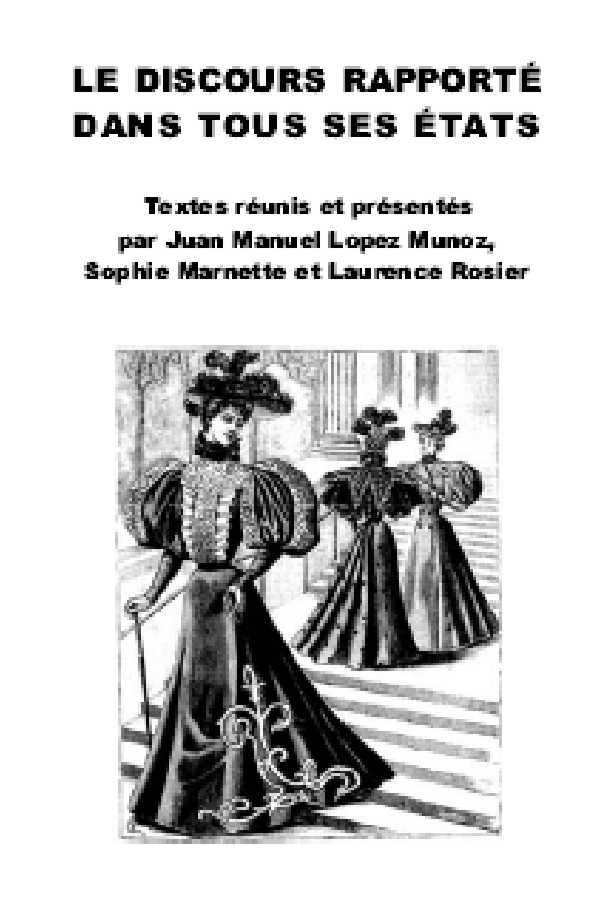
|
Tiré
de
Le discours rapporté dans tous ses états
: Question de frontières, édité par
Juan Manuel Lopez Munoz, Sophie Marnette et Laurence Rosier,
L'Harmattan, 2004, p. 193.
|
EXTRAIT
Le texte que
nous avons retenu atteste la présence du discours indirect
libre (désormais DIL) comme mode discursif récurrent,
parfaitement bien intégré à la structure linguistique.
Il s'agit du Roman de Brut de l'écrivain normand Wace
(c. 1100 - après 1174). Ce texte, de 14866 vers octosyllabiques,
achevé en 1155, est une libre adaptation de l'Historia regum
Britanniae de Geoffroy de Monmouth, histoire qui va de la fondation
mythique de la (Grande-) Bretagne par le troyen Brutus, arrière-petit-fils
d'Énée, jusqu'à la fin du VIIe siècle
de notre ère, l'époque du vénérable
Bede. Le Brut a été lui-même adapté avant
1200 par Layamon, dont le poème de 32000 vers est l'un des
premiers rédigés en moyen anglais. Wace, dans son
roman, raconte notamment la légende du roi Lear et celle
d'Arthur, qu'il développe sur plus de 4000 vers, faisant
ainsi de son œuvre le premier roman breton de la littérature
française.
Notre analyse s'attachera d'abord à préciser sous
quelles formes se manifeste le discours indirect libre dans le Brut,
pour ensuite discuter de la nécessité de faire intervenir
des données contextuelles dans le repérage de ce type
de rapport de parole. Finalement, en complément de l'analyse
du Brut, nous examinerons les manifestations de DIL dans l'œuvre
complète de Wace.
Le Brut accorde une place importante au « rapport »
de parole. On ne s'étonnera pas de l'exploitation des paroles
dans ce qui est, après tout, une chronique : le compte rendu
des événements marquants passe par les actions mais
aussi par les paroles, et de façon non négligeable
par les points de vue – perceptions et pensée.
1. Les manifestations
du DIL
Nous nous sommes limités, pour des raisons pratiques, à
l'examen de la reproduction de la parole, de propos effectivement
prononcés, laissant de côté les pensées
rapportées. Pour mieux cerner le DIL dans ses exemples-types,
nous avons privilégié une approche syntaxique dans
la tradition de Charles Bally. Le DIL apparaît comme un écart
par rapport aux formes canoniques du discours direct (DD) et du
discours indirect (DI), qui se manifeste principalement de façons
suivantes :
- comme une
translation dans le discours à rapporter : transposition
des temps et modes et des repères déictiques, par
rapport à un discours direct possible (dans nos textes,
il arrive que ce dernier succède à un DIL, mais
il ne le précède jamais).
- comme un
décrochage énonciatif : bris de construction, par
rapport au discours indirect ou à la simple narration;
développement d'un énoncé, par rapport au
discours narrativisé.
(...)
5. Conclusion
L'étude du Brut de Wace confirme le fait que le discours
indirect libre est attesté dans des écrits très
tôt dans l'histoire littéraire. L'écrit comporte
en fait toute une gamme de rapports de parole, allant du discours
direct au discours indirect qui se prolonge souvent par une série
énumérative marquée ou non de la conjonction
de subordination, vers le discours indirect libre avec ou sans incise.
De plus, il n'est pas rare de les trouver agencés dans un
même extrait : ils renforcent alors l'importance de la parole
citée sous des formes multiples dans ce genre qu'est la chronique
où les discours échangés font partie intégrante
de la trame événementielle. Le discours indirect libéré
ou libre semble satisfaire au besoin du narrateur de relater selon
son bon vouloir, tout en intégrant par moments la parole
d'un personnage qui semble s'exprimer devant nous. Lorsque les différentes
formes de rapport de parole sont agencées les unes aux autres,
l'analyste peut parfois éprouver une difficulté à
les catégoriser; ce qui confirme que les modalisations dans
le rapport de parole relèvent d'un continuum. Le discours
indirect libéré ou libre trouve tout naturellement
sa place dans cet ensemble narratif comme en témoigne la
variété des formes qu'il revêt et la souplesse
avec laquelle il transmet le contenu événementiel.
|
|